Parler Sarthois
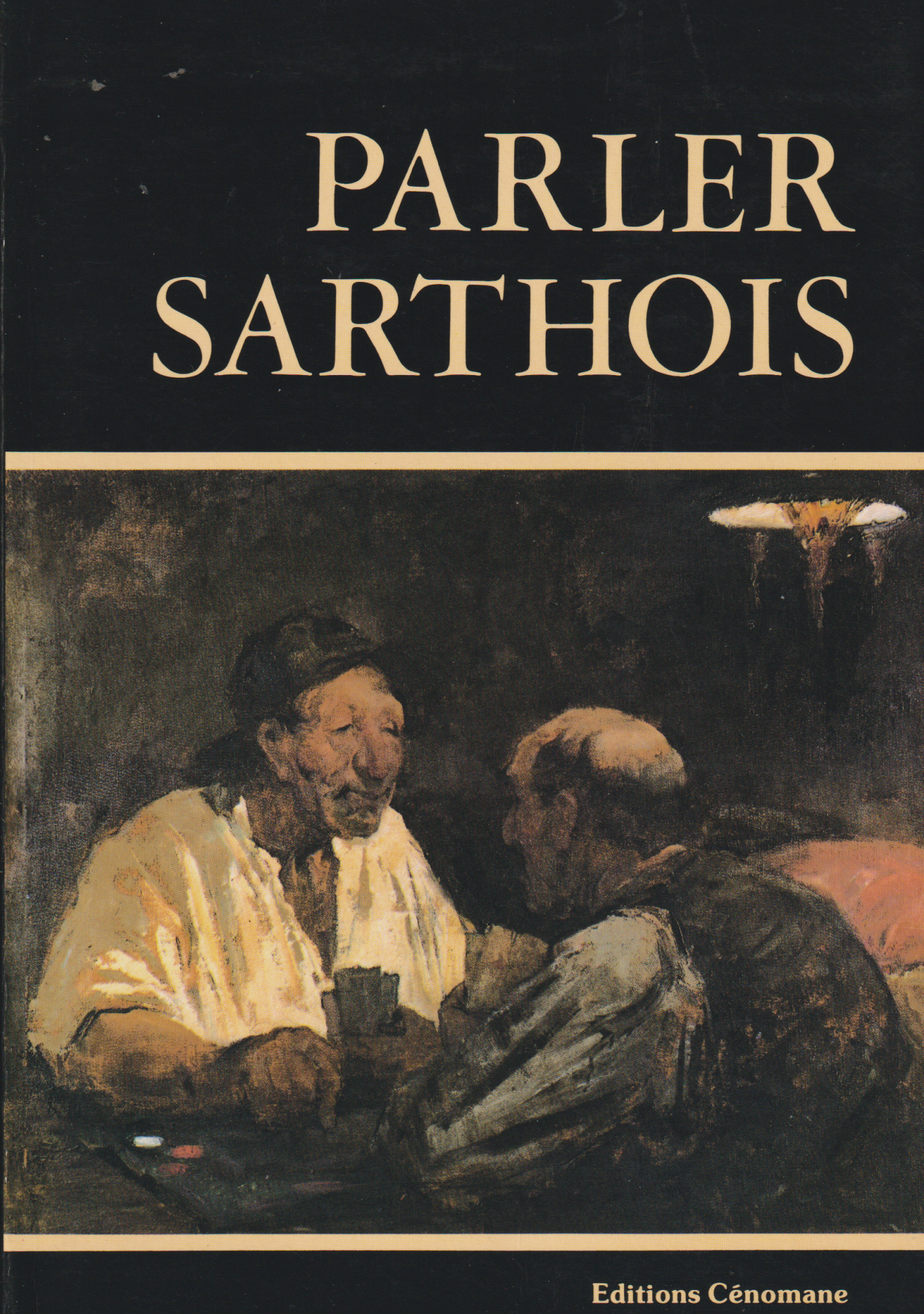
Parler Sarthois
Préambule
Ce volume n’est pas le glossaire d’une langue morte. Dans son titre, Parler Sarthois, ‘’parler’’ est un verbe, donc un acte. En l’occurrence, Cénomane veut signifier que le lexique qu’elle a rassemblé est celui d’une langue qui rougeoie encore comme une braise sous la cendre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’est pas figé dans l’avant-guerre. Il n’est pas seulement d’antan. Parler Sarthois n’est pas l’autopsie mais l’anatomie d’un langage d’aujourd’hui. Mais actuellement, quelques ouvrages sont introuvables, le Montesson est difficile à dénicher ; le Verdier est épuisé. Des mots, des expressions se sont perdus dans une déruralisation continue. »

Intéressons-nous à : Et si on caôsait patois !
Dans le livre de Fernand Legeard, préface de Serge Bertin, docteur en ethnologie (Université de Bretagne Occidentale)
Patoisez, patoisez…
Il en restera toujours quelque chos@e !
Quoi de neuf ?
Un ouvrage en patois !
Eh oui, vous ne rêvez pas. Le patois est devenu tendance. On le croyait disparu, plongé dans les oubliettes de nos mémoires et puis, tel le phénix, le voilà qui réapparait. Les anciens le retrouvent avec nostalgie, les jeunes le découvrent avec gourmandise. En témoignent, les succès remportés par toutes les initiatives qui le mettent en valeur, depuis les spectacles jusqu’aux jeux de société, des BD aux chroniques de télé. Ses mots, ses expressions reprennent vie, ici ou là. Nostalgie stérile, passéisme ridicule, grinceront les grincheux les contempteurs béats du progrès à tout va et du grand n’importe quoi. Laissons-les dire et médire. Contentons-nous de jouir du simple plaisir de sourire de ses tournures savoureuses, de se jouer de ses mots, de les déguster à pleine dent, dans ses Heulâ et ses vanquiers.
Sachons éprouver à nouveau les plaisirs simples, ces petits rien qui nous rassurent car ils s’appuient sur le vécu de ceux et celles qui nous ont précédés. […]
Et si on jouait à caôsait patois !
Nous allons commencer par un Mariage à la campaîgne
Quand’ qu’j’ai été en âge d’me marier, moué, j’voulais prendre en épousailles la fille de l’épicier, la Brigitte Cahoreau, c’té déjà ma bonne amie à l’école.
Mes gens y z’ont rin voulu savouér, y voulaint que j’prenne la Marcelle Courdoisy, nôte vouésine qu’avait l’kuil térreux d’quatre-vingts journaux, pisque fille unique. Et en pu d’ça, leu terres é bordé les nôtes.
El’té pâ agoussante, c’té pâ un épouantal mais é me plaisait pouint. »
Je vais être obligé de marquer un sérieux ‘’Temps d’Arrêt’’, et ceci pour plusieurs raisons.
- 1 Mon ordinateur n’obéit pas ce nouveau langage.
- 2 Je suis incapable, avec certains mots, de suivre ces dialogues.
- 3 en trois mots ‘’je suis ringardisé’’
Mais, pour ‘’ceux’’, qui comme moi, éprouvent encore quelques difficultés à décrypter ces conversations ; je vais vous soumettre une traduction de quelques mots, d’une tournure plus conventionnelle. (Selon les auteurs)
- 1 Gens = Parents
- 2 l’kiul terreux = Fille qui a de la terre en dot
- 3 agoussante = Pas attirante
- 4 épouantal = Épouvantail
- 5 glèbe = Terre
- 6 couiner = Hésiter
- 7 hardeau = Garçon
- 8 chérigauder = Courtiser
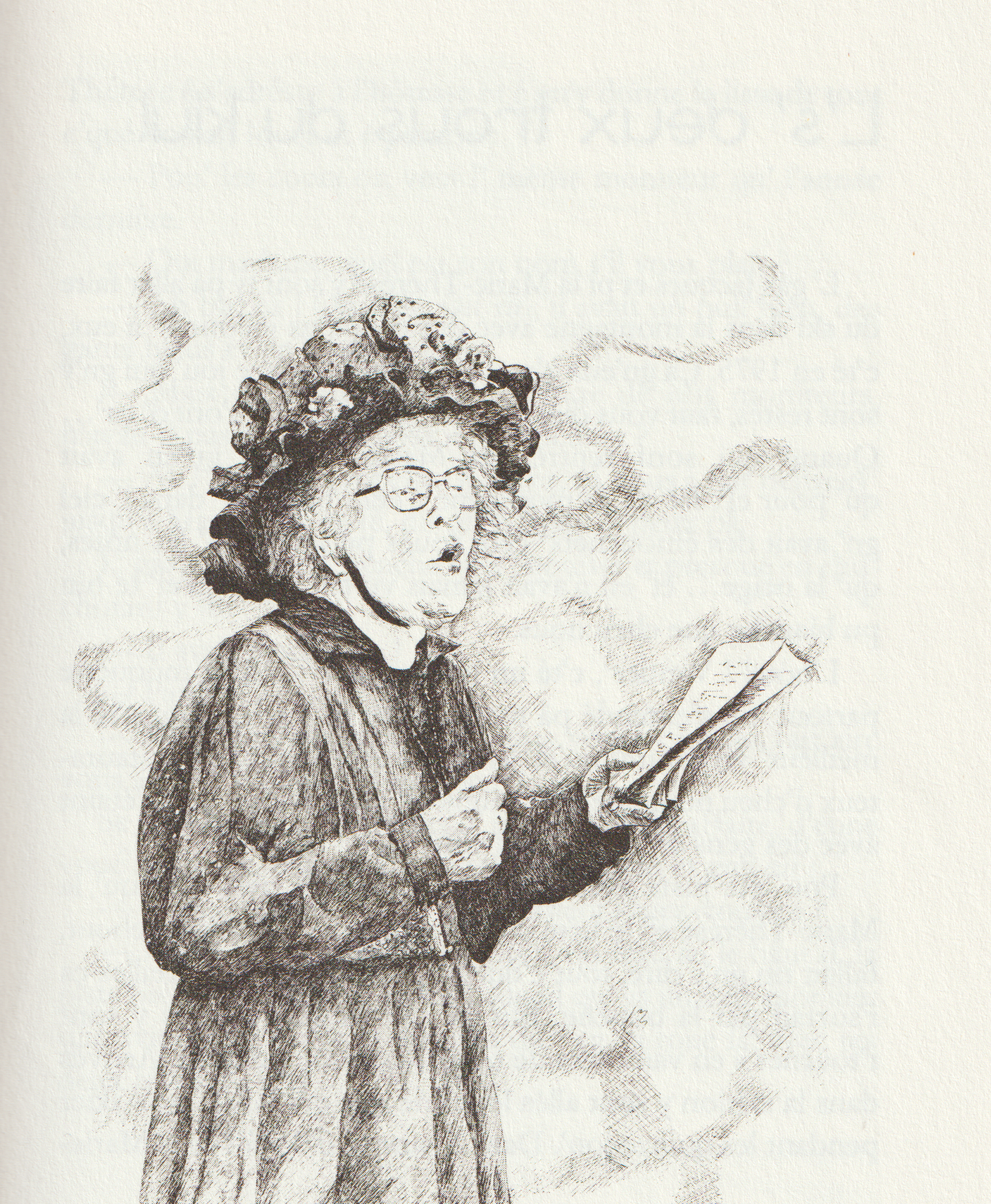
Ces journées de vie à la campagne autrefois, nous incitent à en saisir encore d’autres moments. La soirée par exemple :
En r’venant d’la veillèe
Un souèr de janvier qui v’f’sait grand fré et qu’la ventouse el’té forte, je r’venais d’veillée chez des coupains.
J’tais tout affribaudi, ben tapi dans ma flôpe, ben encapuchonné.
L’ciel y luisarnait, l’clair de leune il’té jaunâtre. La bise è subié lugubrement dans les cyprès du cimquière, les houilleries d’la fersaë è donnint une sambiance increyable, comme si on allait à la d’vallée dans les limbes.
J’venais d’marrouter quan’ que près du champ d’naviot, j’voué un hardeau et une hardelle ben jeunots.
Y z’étaint bourdés au daura du mur, y’m’dônnant l’appérânce qui z’avaien poû d’vant la dernière âitrise des gens d’la commune.
Quand que j’fus à coûté d’eux l’gars y vint m’caôser :
-Maître, j’s’ai ben bénaise d’vous vouér , ma promise et moué on n’est ben émeillés à l’idée d’pâsser d’vant c’t’endré à la sambiance ben ténébreuse.
-J’sais ben daquédent avec vous, qu’j’y d’une voué carverneuse. Quand’ qu’cest qu’javais voûtre âge et qu’jétais cor vivant…
J’n’ai pouint y’u l’temps d’en dire pû, y sont partis d’une virée, la hardelle elle a eu tellement poû qu’elle a eu des poulettes aux yeux et elle partit en hurlant comme l’guiâbe à la d’vallée.
Comme nous l’avons déjà fait pour ‘’Un mariage à la campaîgne’’, traduisons les termes ou mots en patois :
- 1 affribaudi= avoir froid, frissonner
- 2 flôpe, = manteau large
- 3 luisarnait = lueur pâle, sinistre
- 4 subié = siffler
- 5 houilleries = cri lugubre plein de noirceur
- 6 fersaë = chouette
- 7 naviot = cimetière
- 8 hardeau = jeune homme
- 9 hardelle = jeune fille
- 10 bourdés = arrêter
- 11 daura = auprès de
- 12 poû = peur
- 13 aîttrise = demeure
- 14 bénaise = heureux
- 15 émeillés= ému, préoccupé
- 16 daquédant = être d’accord
- 17 poulettes = avoir des yeux exorbités
- 18 d’vallée = partir en courant, la peur au ventre

Je m’arrête sur cette soirée à la campagne, pensant vous avoir permis d’apprécier les textes les mots et l’ambiance du parler Sarthois ; ainsi que celui, de : Et si on caôsait Patois.
S’il vous est possible de continuer, ces livres sont encore dans les bibliothèques. Le plaisir à les lire est toujours un moment de bonheur !!!
J’ajouterai que Serge Bertin fait des conférences, dans des salles de campagnes, ou même en villes. L’ambiance y est toujours conviviale et théâtrale, et se terminent, tout le temps, par de longs et forts applaudissements !
Date de dernière mise à jour : 24/04/2025
